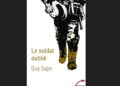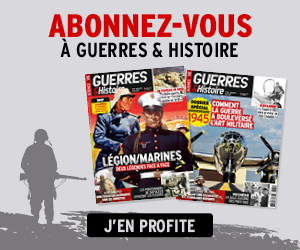Après la fin de la guerre franco-allemande, Otto von Bismarck, chancelier du nouvel Empire allemand, cherche à isoler la France et à maintenir la stabilité en Europe centrale et orientale. Il convainc l’empereur Guillaume Ier, de signer un accord avec l’empereur d’Autriche, François-Joseph, et le tsar russe, Alexandre II. L’alliance des trois empereurs vient de naitre.
Trois empereurs et une alliance
Cet accord se concrétise en trois temps. Le 6 mai 1873, Allemagne et Russie signent une convention militaire. Elle stipule qu’en cas d’attaque par une puissance européenne, l’autre empire apporterait un soutien de 200 000 hommes. Un mois plus tard, Russie et Autriche signent un accord, engageant François-Joseph et Alexandre II à se consulter en cas de divergences ou de menace de paix par une tierce puissance. Guillaume Ier adhère quelques mois plus tard à cette convention, scellant ainsi l’Entente des trois empereurs à Vienne.
Tous contre la France
Cette alliance informelle renforce temporairement la position de l’Allemagne en Europe et isole diplomatiquement la France. Elle est cependant rapidement mise à l’épreuve lors de la crise franco-allemande de 1875 puis s’effrite face aux intérêts divergents des empires, notamment dans les Balkans. Si l’Entente marque le début des « systèmes d’alliances bismarckiens », elle révèle aussi la fragilité des équilibres européens, préfigurant les tensions qui ont mené aux conflits du début vingtième siècle.
En mars 1875, une loi française réorganisa l’armée et augmenta le nombre des officiers et des sous-officiers. Bismarck craignant une guerre préventive réagit aussitôt. Le ministre français des Affaires étrangères, le duc Decazes, se tourne alors vers l’Angleterre et la Russie. L’Entente des trois empereurs se fissure irrémédiablement.
Bismarck se tourna vers de nouvelles alliances à partir de 1879. Ce fut la deuxième phase des systèmes bismarckiens.