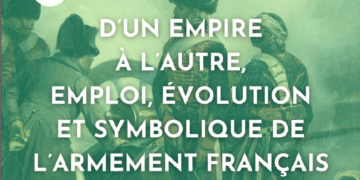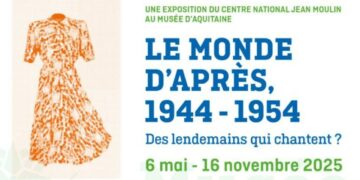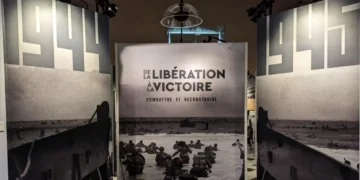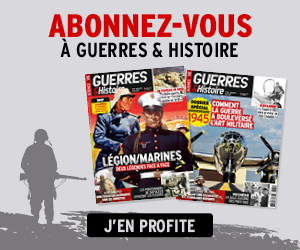Un chef-d’œuvre médiéval au cœur du Périgord noir Dominant la vallée de la Dordogne, le château de Castelnaud est une étape obligée pour les amateurs d’histoire militaire.
Un emplacement stratégique
Le château de Castelnaud occupe une position stratégique exceptionnelle perché sur un promontoire rocheux qui surplombe la confluence de la Dordogne et du Céou. Ses occupants dominaient les axes de navigation et de commerce. La hauteur offrait ainsi un point de vue parfait pour surveiller déplacements de troupes ennemies. Il fait face à lui, sur l’autre rive, au château de Beynac.

Aux origines du château de Castelnaud
La première mention du château de Castelnaud remonte au XIIᵉ siècle. Cette période était le théâtre de luttes d’influence entre royaume de France et duché d’Aquitaine. Construit par les seigneurs locaux, le château a d’abord été une forteresse défensive conçue pour contrôler la vallée. Au fil des siècles, l’édifice a connu de nombreuses transformations, subissant reconstructions, agrandissements et adaptations aux évolutions de l’art de la guerre. Si la structure primitive demeure enfouie sous les restaurations ultérieures, les vestiges du donjon roman, des remparts imposants et des tours témoignent encore aujourd’hui de cette époque tumultueuse.
La guerre de Cent Ans et l’âge d’or de Castelnaud
Le château occupe une place centrale pendant la guerre de Cent Ans. Pris et repris, il passe souvent d’un camp à l’autre au gré des alliances et des conquêtes. Sous le règne de la famille Caumont, Castelnaud devient une place forte anglaise. En mars 1437, après seize années d’occupation anglaise, le château est repris puis française.
Castelnaud, architecture militaire remarquable
L’architecture du château de Castelnaud illustre parfaitement l’évolution des techniques de défense médiévales. Son plan irrégulier épouse les contours du rocher,. Ses remparts puissants, flanqués de tours massives, impressionnent par leur capacité à repousser les assaillants.
Parmi les éléments les plus remarquables, on trouve à Castelnaud :
- Le donjon roman : massif et sobre, il offre une vue panoramique sur la vallée et servait de dernier refuge en cas d’attaque.
- La barbacane et la courtine : défenses avancées protégeant l’entrée principale.
- Les mâchicoulis : permettant de jeter des projectiles ou des substances brûlantes sur les assaillants.
Les logis seigneuriaux : témoignages de la vie quotidienne des seigneurs et de leur cour.

Un musée vivant de la guerre au Moyen Âge
En 1965, Philippe Rossillon, rachète le château de Castelnaud avec son épouse, Véronique Rossillon, pour le rénover. En 1985, son fils, Kléber Rossillon prend sa suite et ouvre le château au public.
Depuis 1985, le château de Castelnaud abrite le Musée de la guerre au Moyen Âge. Il propose une muséographie moderne et immersive, avec une collection exceptionnelle d’armes, d’armures, de maquettes et de documents. On peut y découvrir :
- Des épées, hallebardes, boucliers et armures portées par les chevaliers et soldats.
- Des reconstitutions de sièges et de batailles commentées.
- Des animations et démonstrations de tirs de machines de guerre.
Le château abrite également une impressionnante collection de machines de guerre : trébuchets, mangonneaux, couillards et arbalètes reconstitués à l’identique d’après les sources médiévales. Ces engins spectaculaires sont régulièrement mis en démonstration, offrant un aperçu saisissant de l’ingéniosité et de la puissance des armes d’autrefois.






Une acquisition exceptionnelle
Jeudi 22 mai, à l’hôtel des ventes Drouot de Paris, le musée de la guerre au Moyen Âge a frappé fort. Il s’est offert un véritable témoin de l’Histoire, un veuglaire. Ce redoutable canon a joué un rôle clé lors de la bataille de Castillon en 1453. Cette victoire décisive des troupes françaises mit fin à la guerre de Cent Ans. Une pièce rare, chargée de poudre… et de mémoire ! Ce type de canon a largement contribué à la supériorité tactique des armées françaises à la fin de la guerre de Cent Ans..
Le veuglaire, arme clé de l’artillerie française
Les veuglaires étaient des pièces d’artillerie de moyen calibre à volée relativement longue. Ils lançaient des boulets de pierre de petite dimension, employés de préférence en campagne ou contre le personnel des places fortes.
Afin d’augmenter la cadence de tir, les artilleurs utilisaient une chambre à poudre amovible. Ces boîtes étaient fixées à l’arrière du tube. Chaque pièce avait ainsi plusieurs boîtes associées. Ainsi, les artilleurs enchaînaient les chargements et ainsi augmentaient leur cadence de tir. Montés sur des affûts à roues, les veuglaires, dont les calibres varient du plus petit au plus gros, sont des pièces très mobiles et deviennent ainsi sous Charles VII le premier type d’artillerie de campagne. Le développement d’un véritable train d’artillerie au sein de l’armée française est alors largement dû aux innovations et réformes administratives et techniques des frères Jean et Gaspard Bureau, à propos desquels les chroniqueurs du temps ne tarissent pas d’éloges, et qui dirigèrent l’artillerie royale lors de la campagne de Guyenne de 1453.
La bataille de Castillon
A Castillon, le 17 juillet 1453, ce furent ainsi d’après les chroniques, près de 300 pièces d’artillerie (toutes tailles et types confondus), qui défendirent le camp fortifié des Français installé par les frères Bureau. Associée à de nouvelles tactiques, elle remporte de nombreuses batailles face aux Anglais et précipite l’issue de la Guerre de Cent Ans en faveur des Français. Montés sur des affûts à roues, les veuglaires, dont les calibres varient du plus petit au plus gros, sont des pièces très mobiles et deviennent ainsi sous Charles VII le premier type d’artillerie de campagne.
Repêchées au fond de la Dordogne avec les célèbres épées du « groupe de Castillon », ces trois pièces pourraient être les seuls témoins survivants de l’artillerie royale de Charles VII, utilisée lors de la bataille de Castillon. La pièce acquise conserve encore des traces de poudre noire vieille de plus de cinq siècles, ainsi que quelques fragments de bois de l’affût, emprisonnés dans la rouille. Ce canon figure donc parmi les seules pièces d’artillerie connues du groupe de Castillon, vestiges rarissimes du feu royal de 1453.


Le déclin et la renaissance du château
Comme beaucoup de forteresses médiévales, Castelnaud connaît un lent déclin après la fin des guerres de religion et la pacification de la région sous Henri IV. Délaissé par ses propriétaires, il tombe progressivement en ruine, servant parfois de carrière de pierres pour les villages alentour.
Il faut attendre le XXᵉ siècle pour que l’on mesure à nouveau toute la valeur historique et patrimoniale du site. Grâce à l’engagement de passionnés, d’archéologues et d’institutions, le château fait l’objet d’importantes campagnes de restauration dès les années 1960. Il retrouve alors sa silhouette imposante et devient un haut lieu touristique du Périgord.
Une visite pour toute la famille
La visite du château de Castelnaud séduit par la richesse de son environnement naturel. Balade, nautisme, la beauté du panorama sur la vallée de la Dordogne, invite à la découverte de la région. L’équipe du château propose des activités très variées en plus des visites théâtralisées. De nombreux ateliers pédagogiques sont organisés pour les enfants et les scolaires : initiation au maniement de l’épée, découverte de l’art héraldique, fabrication de blasons ou d’enluminures.
Chaque été, des spectacles nocturnes font revivre la magie et la grandeur du Moyen Âge. La boutique propose des livres, des objets d’artisanat et des souvenirs inspirés de l’histoire du lieu.