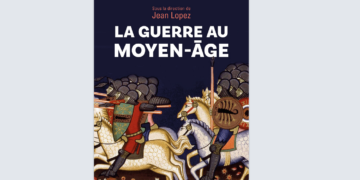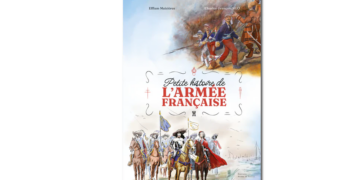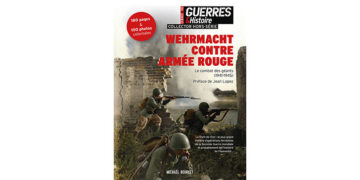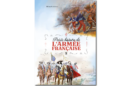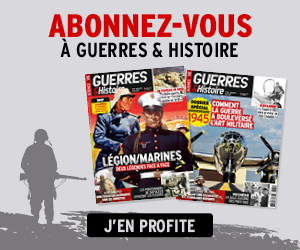.«L’année 1214, le 27 juillet tombait un dimanche. Le dimanche est le jour du Seigneur. On le lui doit tout entier. J’ai connu des paysans qui tremblaient encore un peu lorsque le temps les forçait à moissonner le dimanche. Ils sentaient sur eux la colère du ciel.» Ainsi s’ouvre le livre de Georges Duby consacré à Bouvines. En 1973, au plus fort du règne impitoyable de l’École des annales sur l’Université française, Duby choisit « par plaisir » d’écrire un texte centré sur un événement, une bataille, une journée et, pire encore,sur les phénomènes de filiation qui nous y rattachent. Destiné, quel sacrilège, à la collection grand public « Trente journées qui ont fait la France », le livre présente un texte érudit et complexe, mais sans note ni renvoi aux sources.
Pour autant, la bataille n’occupe que peu de pages. Duby propose un récit court et très cru de la journée de Bouvines. Il présente les acteurs, le décor et l’intrigue, à la manière d’une pièce de théâtre classique avec son unité d’action de temps et de lieu.Il s’appuie pour cela sur les écrits d’un témoin direct et proche de Philippe Auguste, en la personne de Guillaume le Breton. On y découvre un roi de France engagé en Flandre avec son armée, bientôt pourchassé par Otton, l’empereur excommunié, et ses alliés. Philippe Auguste décide de faire face et de livrer une bataille. Pourtant lui-même et ses contemporains la présentent après coup comme la victoire du Bien contre le Mal. Cette une perspective éminemment chrétienne est de moins en moins aisé d’envisager aujourd’hui comme naturelle. C’est dans sa deuxième partie, le commentaire, que le livre prend de l’ampleur.
Duby revient à ses fondamentaux pour replacer la bataille dans l’histoire de la société féodale du Nord de la France et de ses mentalités. Il est bien sûr question de l’art de la guerre au XIIIes. Comme il évoque la manière dont la chevalerie s’y prépare avec les tournois. Comment on recrute la piétaille des milices communales et comment celles-ci participent à la bataille. De manière plus globale, il est aussi question de l’influence de l’Église sur la façon d’envisager la guerre et de l’importance de l’argent pour la financer. Tout cela permet de mieux comprendre, une fois remises en perspective, les notions de guerre, de trêve ou de paix dans le contexte médiéval.
La dernière partie s’attache à la naissance du mythe autour de Bouvines. Après le désastre de 1870, il va prendre une place privilégiée dans notre si controversé « roman national ». Philippe Auguste, comme symbole de l’émergence de la nation française, y défait un empereur allemand…
Le Dimanche de Bouvines est un livre écrit à contre-courant des codes historiographiques de son époque. Il est pour cela un ouvrage fondamental pour le renouveau en France de l’histoire militaire. S’il s’inscrit aussi dans l’histoire événementielle, il demeure, dans sa forme,attaché à un schéma assez classique. La journée de la bataille est décrite puis expliquée. Et l’explication est ensuite prolongée d’un exposé de problèmes et perspectives d’ensemble. On ne rencontre pas dans l’ouvrage de cartes ou schémas détaillés sur le déroulement de la bataille ni d’étude sur les troupes. Pourtant l’amateur de jeux d’histoire trouvera, en annexes, la liste exhaustive des milices communales présentes en ce 27 juillet. Tout en ayant contribué à restaurer le prestige de l’histoire-bataille, ce livre reste assez éloigné de ce qu’elle deviendra au cours des années suivantes.
Le Dimanche de Bouvines
Georges Duby Gallimard, 1973 (réédition coll. Folio Histoire, 1985)